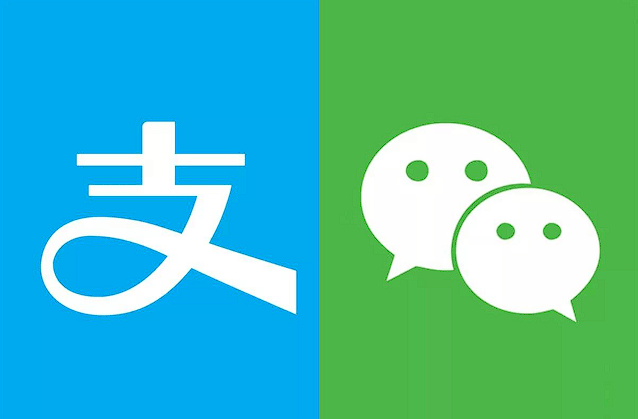Les « villes fantômes » en Chine
Dernière modification le 11/08/2025
Imagine une ville ultra-moderne : tours imposantes, autoroutes larges, centres commerciaux dernier cri… mais pratiquement sans habitants. Tu es peut‑être dans une vraie « ville fantôme » chinoise. Dans cet article, je t’explique ce que sont ces villes, pourquoi elles existent, et surtout si elles sont vraiment vides comme on le dit.
Une « ville fantôme », c’est quoi au juste ?
En Chine, on parle de villes fantômes (鬼城 guǐ chéng) pour des zones urbaines construites rapidement avec tous les équipements (hôpitaux, écoles, routes), mais peu peuplées.
Il ne s’agit pas de villes abandonnées, mais de villes construites plus vite que la demande réelle.
Pourquoi ces constructions massives ?
Urbanisation exponentielle
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la Chine a poussé à une urbanisation massive. Pour accueillir les millions de ruraux voulant migrer en ville, il fallait construire… vite.
Un urbanisme piloté par le profit foncier
Les autorités locales génèrent des revenus importants via la vente de terrains, ce qui favorise la construction anticipée. Parfois, trop vite.
Un marché immobilier atypique
Beaucoup achètent des logements comme investissement, pas pour y vivre. Et certaines familles possèdent deux ou trois biens non habités.
➡️ Cela crée des quartiers bétonnés entièrement inoccupés.
La crise immobilière chinoise : l’arrière-plan économique
En 2024, la bulle immobilière a éclaté. Plusieurs géants du secteur, tels que Evergrande et Country Garden, ont fait défaut sur leurs dettes et ont dû entamer des restructurations massives.
Vanke, autre grand promoteur, a vu sa note financière dégradée et est désormais sous l’œil du contrôle étatique via Shenzhen Metro pour éviter un effondrement total.
La crise s’est traduite par une baisse des prix de l’ordre de 10 % en 2024 et une chute des ventes attendue de 15 % en 2025.
📉 Ces difficultés montrent que de nombreux promoteurs ont construit trop, trop tôt, accentuant le phénomène des villes sous-peuplées.

Exemples emblématiques de villes fantômes
Kangbashi (Ordos, Mongolie intérieure)
Prévue pour accueillir un million d’habitants, elle en comptait seulement 50 000 pendant longtemps. Aujourd’hui, la population augmente lentement.
Tianducheng (près de Hangzhou)
Réplique miniature de Paris avec tour Eiffel de 108 m. Conçue pour 10 000 personnes, elle n’en comptait que quelques milliers en 2013. Depuis, la population a bondi à 30 000 habitants en 2017, suite à une meilleure connectivité avec Hangzhou.
Xiong’an New Area (Hebei)
Pensée comme une mégapole de 5 millions d’habitants à l’horizon 2035, Xiong’an a été construite sous l’égide directe de l’État. En 2024, elle comptait 1,36 million de résidents, mais reste très peu peuplée dans les zones neuves, ce qui lui donne une ambiance parfois “fantomatique”.
Le projet a même été critiqué pour avoir redirigé des inondations sur des zones habitées, accentuant l’impression d’une ville conçue pour une vision politique plus qu’un usage immédiat.
Zhengdong (Zhengzhou)
Autrefois symbole du vide, ce quartier s’est progressivement densifié et abrite aujourd’hui des universités, des centres d’affaires et une vraie vie citadine.
Villes fantômes : un problème… ou une stratégie ?
Ce qui rassure
- C’est une approche visionnaire : on construit avant l’arrivée des habitants.
- Beaucoup de ces villes en tension se remplissent avec le temps, au rythme du développement économique.
Ce qui inquiète
- Gaspillage d’infrastructures, surendettement des promoteurs, immobilisation de capitaux.
- Inadéquation avec les besoins réels : logements cher, peu de services proches, emplois insuffisants.
Et les investisseurs dans tout ça ? Des rêves brisés pour certains
Pour des millions de Chinois, l’immobilier est une valeur refuge. En l’absence de véritables alternatives de placement (comme la bourse, jugée trop risquée), acheter un appartement est perçu comme un investissement solide.
Surtout quand il s’agit :
- de préparer la retraite,
- de mettre un bien au nom d’un futur enfant,
- ou de faire plaisir à la belle-famille avant un mariage (oui oui, c’est une vraie stratégie matrimoniale 😅).
Mais dans les « villes fantômes », cette stratégie s’est parfois retournée contre les propriétaires.
Le cauchemar des investisseurs individuels
- Des appartements livrés mais jamais occupés, sans services autour (écoles, commerces, transports).
- Des logements invendables ou en forte perte de valeur (jusqu’à –30 % dans certaines zones en 2023–2024).
- Des constructions arrêtées ou inachevées, notamment depuis la faillite ou les blocages d’Evergrande et Country Garden.
- Des emprunts à rembourser, alors même que le bien ne génère aucun revenu locatif.
👉 Résultat : certains propriétaires refusent même de rembourser leurs prêts immobiliers, un phénomène inédit qui a provoqué des vagues de protestation en 2022 et 2023 dans tout le pays.
Un pari à long terme… mais pas sans risque
Investir dans une ville en développement peut encore être rentable, si celle-ci finit par se densifier.
Mais pour cela, il faut :
- une politique locale cohérente,
- des emplois disponibles à proximité,
- et une vraie qualité de vie.
➡️ Or, beaucoup de projets ont été conçus dans une logique de spéculation et de chiffre, pas de viabilité humaine.
Pour conclure
Les villes fantômes chinoises sont le reflet d’une urbanisation à marche forcée, mêlant ambition nationale et déséquilibres du marché.
Si certaines zones finissent par se peupler, d’autres restent désespérément vides, laissant des milliers de familles piégées dans des investissements sans avenir.
En Chine, l’avenir de ces villes – et de leurs habitants fantômes – dépendra de la capacité des autorités à réconcilier développement et réalité sociale.
Et comme on dit ici : “Construire des murs, c’est facile… mais y faire entrer la vie, c’est un autre défi.”