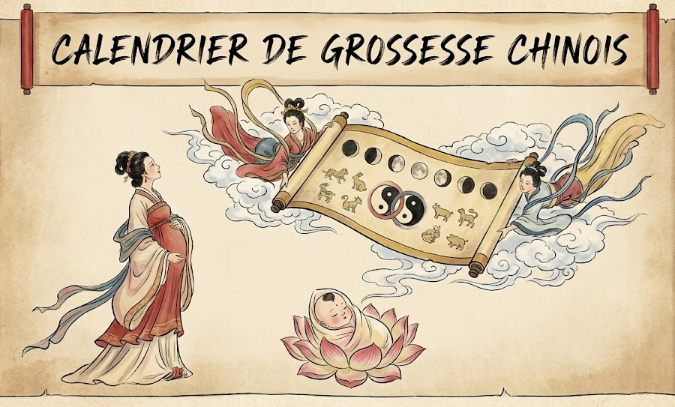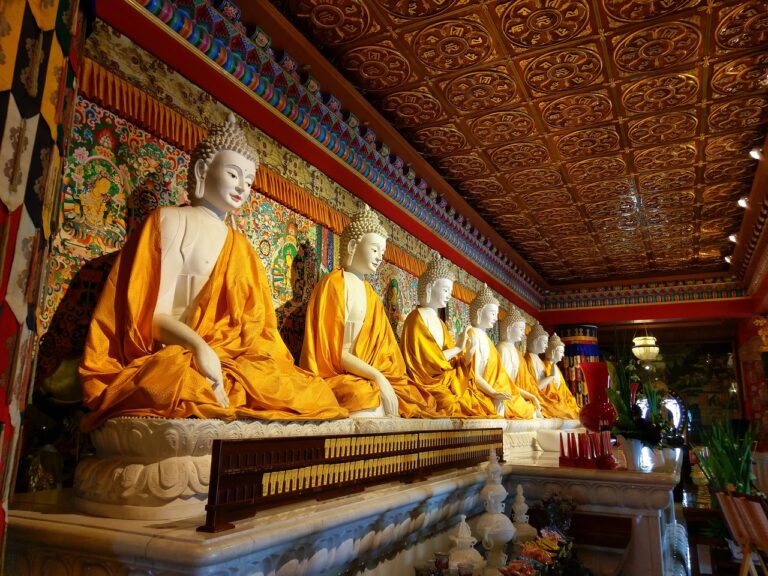La dynastie Tang en Chine
Dernière modification le 15/01/2025
La dynastie Tang (618-907), fondée dans un contexte de compliqué après la chute des Sui, parvint à unifier la Chine et à établir une influence sans précédent à travers l’Asie.
Origines et fondation de la dynastie Tang
La dynastie Sui (581-618), bien qu’unificatrice après des siècles de division, s’effondra rapidement sous le poids de son autoritarisme et de ses projets excessifs, comme la construction du Grand Canal et les campagnes militaires coûteuses contre la Corée. Ces politiques épuisèrent les ressources de l’État et déclenchèrent des révoltes populaires, entraînant la chute des Sui en 618.
La montée de Li Yuan et la fondation des Tang
Profitant de ce climat d’instabilité, Li Yuan, un aristocrate et général de renom, se révolta contre la dynastie Sui. Avec le soutien de son fils Li Shimin, il s’empara de Chang’an, l’ancienne capitale, et fonda la dynastie Tang en 618, prenant le titre d’empereur Gaozu.
Li Shimin, futur empereur Taizong, joua un rôle déterminant dans l’expansion et la stabilisation du pouvoir Tang. En 626, il força son père à abdiquer et devint le deuxième empereur de la dynastie. Sous son règne, les Tang instaurèrent des réformes administratives et fiscales cruciales, comme :
- Le système des champs égaux, qui répartissait les terres agricoles de façon équitable.
- L’introduction d’un système de recrutement par examens impériaux, qui a favorisé une administration méritocratique.

L’apogée de la dynastie Tang
Sous le règne de l’empereur Xuanzong (712-756), la dynastie Tang atteignit son apogée. Surnommé l’Âge d’or des Tang, cette période fut marquée par une stabilité politique, une prospérité économique et un développement culturel sans précédent.
- Xuanzong promut la culture et les arts, soutenant les poètes, musiciens et peintres de son époque.
- Le gouvernement bénéficia de réformes fiscales efficaces et d’un commerce florissant, notamment grâce à l’utilisation de la route de la soie, qui reliait la Chine à l’Asie centrale, au Moyen-Orient et à l’Europe.
L’expansion territoriale et le rayonnement international
Les Tang furent l’une des dynasties chinoises les plus expansionnistes. Sous Taizong et Xuanzong, l’empire étendit son influence bien au-delà de ses frontières :
- La conquête de l’Asie centrale permit d’établir un contrôle sur des territoires stratégiques et d’assurer la sécurité des routes commerciales.
- Des alliances avec des royaumes voisins, comme le Tibet et la Corée, renforcèrent le statut de la Chine en tant que puissance régionale dominante.
- La capitale, Chang’an, devint un centre cosmopolite, accueillant des marchands, des diplomates et des érudits de diverses cultures.
Les échanges sur la route de la soie et le cosmopolitisme de Chang’an
Grâce à la route de la soie, la dynastie Tang devint une plaque tournante des échanges commerciaux et culturels :
- Des marchandises telles que la soie, le thé et la porcelaine étaient échangées contre des pierres précieuses, des épices et des produits de luxe venus d’Inde, de Perse et de l’Empire romain d’Orient.
- Chang’an, la capitale impériale, accueillait des communautés multiculturelles, notamment des marchands arabes, persans, indiens et byzantins. Cette diversité enrichit la culture Tang et favorisa le développement de nouvelles idées dans les domaines religieux, artistique et scientifique.
La société chinoise sous les Tang
Sous la dynastie Tang, la société chinoise était hiérarchisée mais relativement stable. L’aristocratie traditionnelle dominait encore, bien que son pouvoir commençât à décliner au profit des fonctionnaires érudits recrutés grâce au système des examens impériaux. Ce système méritocratique ouvrait l’administration aux talents issus de diverses classes sociales, renforçant ainsi l’efficacité de l’État.
Les paysans, bien que majoritaires, vivaient dans des conditions modestes mais bénéficiaient d’un système agricole qui redistribuait les terres pour éviter les inégalités foncières excessives. En revanche, les artisans et commerçants, bien que prospères, étaient considérés socialement inférieurs dans la hiérarchie sociale.
Également, des communautés venues de Perse, d’Inde, de Corée et d’Asie centrale coexistaient, apportant leurs traditions religieuses, comme le bouddhisme, le manichéisme, et même le christianisme nestorien.

Déclin de la dynastie Tang
La rébellion d’An Lushan et ses conséquences dévastatrices
La rébellion d’An Lushan (755-763) fut un tournant décisif pour la dynastie Tang. An Lushan, un général d’origine turque ayant gagné en influence au sein de l’armée impériale, se révolta contre la cour. À la tête d’une armée puissante, il prit la capitale Chang’an et infligea des défaites significatives aux forces impériales.
Bien que la rébellion fût finalement écrasée, ses conséquences furent dévastatrices :
- Des millions de morts, des famines et des épidémies.
- L’autorité centrale s’affaiblit considérablement, les Tang devenant de plus en plus dépendants de gouverneurs militaires régionaux (les jiedushi) pour maintenir l’ordre.
Les luttes internes et la corruption
À partir du IXe siècle, la dynastie Tang fut minée par des luttes internes au sein de la cour impériale. Les factions rivales s’affrontaient pour le pouvoir, et la corruption devint omniprésente. Les réformes administratives et fiscales furent négligées, ce qui affaiblit encore davantage le gouvernement central.
Les pressions des tribus frontalières et les pertes territoriales
Les Tang, autrefois une puissance militaire dominante, commencèrent à perdre du terrain face à des tribus étrangères et des royaumes voisins. Notamment, la Chine perdit son contrôle sur des régions clés en Asie centrale. Également, les tibétains s’emparèrent de plusieurs territoire stratégiques. Et enfin, les incursions des Khitan, des Ouïghours, et d’autres peuples nomades exacerbèrent l’instabilité de l’empire.

La chute de la dynastie Tang
Après la rébellion d’An Lushan, la dynastie Tang ne parvint jamais à restaurer complètement son autorité centrale. La cour impériale devint de plus en plus dépendante des gouverneurs militaires régionaux (jiedushi), qui administraient leurs territoires comme des fiefs autonomes. Ces seigneurs de guerre, bien qu’officiellement subordonnés à l’empereur, agissaient souvent de manière indépendante, érodant le pouvoir impérial.
Les derniers siècles de la dynastie Tang furent marqués par une série de révoltes paysannes, alimentées par des famines, des inégalités croissantes et des taxes exorbitantes. Parmi ces soulèvements, celui de Huang Chao (874-884) fut particulièrement dévastateur. Huang Chao captura plusieurs villes importantes, y compris Chang’an, provoquant un chaos prolongé dans l’empire.